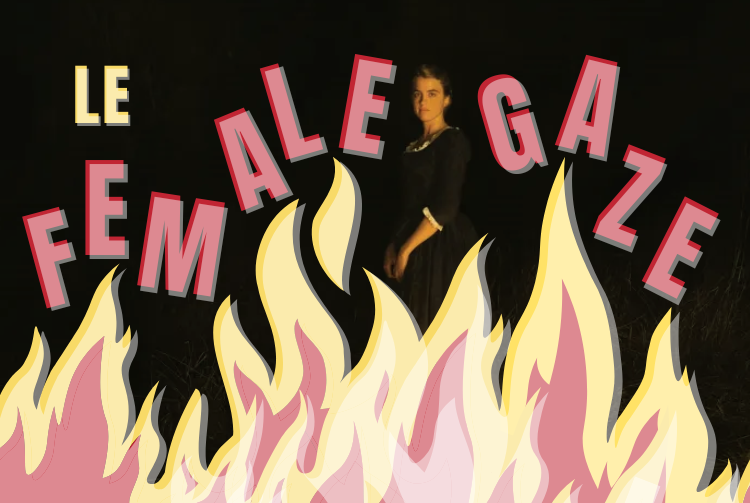Filmer le psychique plutôt que le physique, représenter le corps sans l’objectifier, réaliser un film sans homme (ou alors dans lequel le seul homme est purement utile, au service des femmes). Dans Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma saisit l’insaisissable, renverse les rôles et transforme le cinéma lesbien français qui avait été sali par La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, tentative échouée de parler à la communauté LGBTQ+. Dans ce dernier, sexualisation, idéalisation, fétichisme et oreilles bouchées sur ce qu’est l’expérience lesbienne, ne laissant place qu’à une mise en scène pornograhique de corps féminins. Céline Sciamma use d’un female gaze qu’elle a co-alimenté pour réinventer la représentation des femmes au cinéma.
Point sur le female gaze
Le female gaze est une théorie qui s’oppose à celle du male gaze créée par Laura Mulvey. En 1975, dans Visual Pleasure and Narrative Cinema, elle explique que « le regard masculin projette son fantasme sur la figure féminine, qui est stylisée en conséquence ». On y associe voyeurisme, fétichisme, objectification, et scopophilie (plaisir de posséder l’autre par le regard).
Le female gaze, lui, est un concept plus récent qui définit la manière dont on représente, habille, filme les femmes (et les hommes) sous un regard féminin ou déconstruit. Iris Brey, journaliste et autrice de Le regard féminin – Une révolution à l’écran, affirme que le female gaze « adopte le point de vue d’un personnage féminin pour épouser son expérience ».
Joey Soloway, réalisatrice américaine, divise l’expérience féminine vécue au cinéma en trois concepts.
La « caméra de sentiment » ou « feeling seeing ». « Comme une caméra subjective qui tente de pénétrer à l’intérieur du protagoniste », la caméra donne une place plus importante aux sentiments du personnage plutôt que d’accorder du crédit à son corps, sa représentation.
Le « regard regardé » ou « gazed gaze ». Il s’agit de faire ressentir aux spectateurs la manière dont ils seraient regardés.
Le « retour du regard » ou « returning the gaze ». « C’est le regard sur ceux qui regardent. Il s’agit de ce que l’on ressent lorsqu’on se tient ici, dans le monde, après avoir été vu toute sa vie… ».
Le female gaze réinvente la manière dont les femmes et les hommes, les histoires, les narrations et les représentations ont toujours existé. On connaît l’idéal féminin que portent les hommes à l’écran avec Fenêtre sur Cour d’Alfred Hitchcock (l’exemple préféré du voyeurisme), ou encore la princesse Leia Organa dans sa « tenue d’esclave » dans Star Wars VI. On connaît aussi l’idéal masculin que les hommes se sont auto-attribué avec la figure virile et masculine de James Bond ou de Brad Pitt dans Fight Club. Mesdames, un homme qui sait se battre pourra vous protéger, vous et vos enfants… Mais aujourd’hui, quel est l’idéal (ou les idéaux) masculin et féminin qu’aimeraient porter à l’écran les femmes ?
« Une peintre qui doit regarder un modèle qui se refuse, puis qui se laisse regarder, voire qui la regarde. »
Portrait de la jeune fille en feu, c’est une histoire d’amour entre une femme de la noblesse (Héloïse, incarnée par Adèle Haenel) et d’une peintre (Marianne, jouée par Noémie Merlant). Au XVIIIe siècle, Marianne arrive par bateau (conduit par des hommes) sur une île bretonne pour peindre Héloïse. Le tableau est destiné à un noble milanais qu’elle doit épouser, qu’on ne voit jamais. Seulement, Héloïse refuse de poser, Marianne doit donc observer et mémoriser ses traits. C’est alors que le génie de Sciamma s’impose : elle relève facilement le défi de filmer l’observation sans tomber dans le voyeurisme, en épousant les traits bienvenus d’un female gaze naissant.
Dans une interview à France Culture en septembre 2019 (date de sortie du film), Céline Sciamma explique que « c’est un enjeu de mise en scène, comment on regarde ces personnages féminins toujours comme des sujets pas comme des objets […] en proposant une autre politique du regard ». Loin d’elle l’idée de mettre en scène une peintre qui observe simplement son sujet, comme nous l’aurions tous fait. Dans le film, la réalisatrice crée un personnage qui fait du regard un échange, s’inscrivant pleinement dans le concept du « regard regardé » de Laura Mulvey. « Une peintre qui doit regarder un modèle qui se refuse, puis qui se laisse regarder, voire qui la regarde. » Le sujet, Héloïse, refuse d’elle-même ce gaze qui s’apprête à se poser sur elle, que ce soit celui de Marianne ou celui des spectateurs à travers les yeux de Marianne. Pour répondre à ce regard qui devrait se poser sur elle, Héloïse devient celle qui observe. Les rôles s’inversent. Marianne, la peintre observatrice, devient sujet. Le public, par le biais de regards caméra, devient sujet. Héloïse rejette et reflète ce regard, partageant son expérience, faisant prendre conscience, à sa spectatrice et à ses spectateurs, de ce que c’est que d’être regardé.e. Le regard féminin n’est pas seulement celui qui réinvente les idéaux, c’est aussi celui qui invite le spectateur dans les questionnements du film, voire dans le film. C’est le « retour du regard » de Laura Mulvey.
Un enchevêtrement de female gaze
Dans un film où aucun homme n’est présent, elle défie les conventions d’un monde du XVIII hétéro-normé et peu libéral. Elle inclut un female gaze au sein même de la narration. On pourrait même parler d’un « no gaze » puisque le film se déroule dans le huis-clos d’une île, sur laquelle ni norme, ni homme, ni borne ne peuvent se présenter comme obstacle à leur amour et à leur intimité. Que ce soit sur l’île, dans les échanges inter-regards ou par rapport à la place de la caméra sur le plateau, les personnages et les actrices disposent d’une intimité saisissante. Malgré des jeux de lumière intimistes (éclairage à la bougie au XVIIIe), des échanges timides ou encore un amour physique élusif, le spectateur vit avec les personnages l’histoire qui lui est contée. Le personnel parle à l’universel.
Peut-être que la manière dont Céline Sciamma représente l’expérience unique par le biais du female gaze est ici l’apogée du travail de réalisateur. Le regard féminin ouvre les vannes d’un partage du cinéma, pour que le spectateur se sente, lui aussi, compris par la caméra, lui aussi, acteur de la représentation des personnages. Le female gaze se joue à plusieurs échelles : celle du regard de l’acteur, devant la caméra, celle du regard du réalisateur, derrière la caméra et celle du regard du spectateur, derrière l’écran.
Zélie Bleton Pascal
Crédit photo : Alamode Film
Photo-montage par Zélie Bleton Pascal